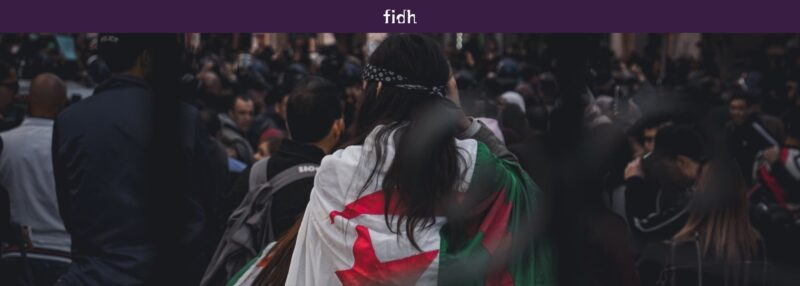Depuis cinq ans et le début du mouvement de protestation du Hirak, les défenseur·es des droits humains et les activistes font face à une répression de grande ampleur, les poussant parfois à l’exil. Dans ce contexte, les organisations signataires, dont la FIDH et l’OMCT dans le cadre de l’Observatoire pour la Protection des Défenseurs des Droits Humains, expriment leur inquiétude et appellent à la fin de cette répression, exhortant les autorités algériennes à respecter les droits fondamentaux consacrés. Elles enjoignent par ailleurs les autorités françaises à mettre fin au harcèlement des militant·es présent·es sur leur territoire et à garantir la liberté d’expression.
22 février 2024. Il y a cinq ans, le 22 février 2019, la population en Algérie s’est mobilisée de manière spontanée et pacifique pour exiger un changement démocratique. Descendant dans les rues d’Alger et d’autres villes du pays, elle protestait contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika, président en exercice, à un cinquième mandat. Même après son retrait, le mouvement de contestation n’a pas perdu de son élan, élargissant ses revendications pour la refonte profonde du régime, en quête d’un « État civil et non militaire », d’une « transition démocratique indépendante du système clanique mafieux », ainsi que d’une « Algérie libre et démocratique ».
Bien que la pandémie de la Covid-19 ait momentanément mis un frein aux manifestations à partir de mars 2020, la mobilisation a repris en février 2021 avant de connaître un déclin définitif, en partie dû aux efforts concertés des autorités pour réprimer le mouvement, pourtant pacifique.
Le harcèlement policier et l’intimidation des activistes, en particulier de celles et ceux qui osent critiquer les discours et politiques du gouvernement, sont incessants. Les forces de sécurité les surveillent et les menacent, créant un climat de terreur qui risque d’être fatal à l’activité de défense des droits humains. Dans certains cas extrêmes, des activistes sont même confronté·es à des violences physiques, voire à de la torture, compromettant leur sécurité, leur intégrité physiques et leur capacité à poursuivre leur révolution.
L’instrumentalisation de la justice par la police politique en Algérie constitue la clé de voûte de cette répression. Le pouvoir judiciaire s’appuie régulièrement sur des dispositions légales ambiguës pour soumettre les militant·es des droits humains à des procès injustes et les maintenir sous son joug, bafouant ainsi le droit à un procès équitable.
Les autorités s’appuient sur des accusations telles que la « déstabilisation de la sécurité de l’État », « atteinte à l’unité nationale », la « perturbation de l’ordre public », privant fréquemment des individus de leur liberté sans transparence ni procédure régulière. Cette pratique viole non seulement les droits fondamentaux des activistes, mais perturbe gravement leurs efforts pour plaider en faveur d’un changement démocratique effectif.
L’organisation et la participation à des rassemblements pacifiques demeurent aussi un défi majeur pour les activistes en Algérie. Les obstacles bureaucratiques pour obtenir des autorisations à manifester, associés à la présence excessive de la police lors des rassemblements approuvés, portent atteinte à la liberté de réunion pacifique, fondamentale à toute démocratie. Actuellement, toute forme de manifestation pacifique opposée au régime militaire est interdite. Preuve en est, les moindres tentatives de sortie militante sont réprimées et leurs meneur·ses arrêté·es.
De plus, les rapports de torture et de mauvais traitements dans les établissements de détention dressent un tableau sombre des conditions auxquelles sont confronté·es les activistes. De telles violations portent atteinte à la dignité des individus et contreviennent au droit international des droits humains, soulignant le besoin urgent de réformes et de responsabilité au sein de ces institutions.
A ce jour, les prisons algériennes comptent des dizaines de détenus d’opinion, à l’exemple de Mohad Gasmi qui n’a pu assister à l’enterrement de son père décédé récemment. D’autres militants sont la cible d’arrestations arbitraires. C’est le cas, notamment, de Mohamed Tadjadit, interpellé chez lui à Alger, le 31 janvier 2024.
Les autorités algériennes utilisent de manière abusive tout l’arsenal législatif restrictif à leur disposition afin de museler la société civile et de faire taire toutes les voix dissidentes et critiques en recourant à divers moyens pour faire obstacle au libre exercice des droits à la liberté d’association et de réunion, tels que la dissolution arbitraire d’associations, l’arrestation et les poursuites judiciaires à l’encontre de leurs dirigeant·es et de leurs membres, ou encore la répression violente et l’empêchement physique des manifestations pacifiques par de très massifs déploiements policiers et parfois par une répression violente.
Source: FIDH