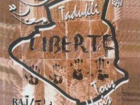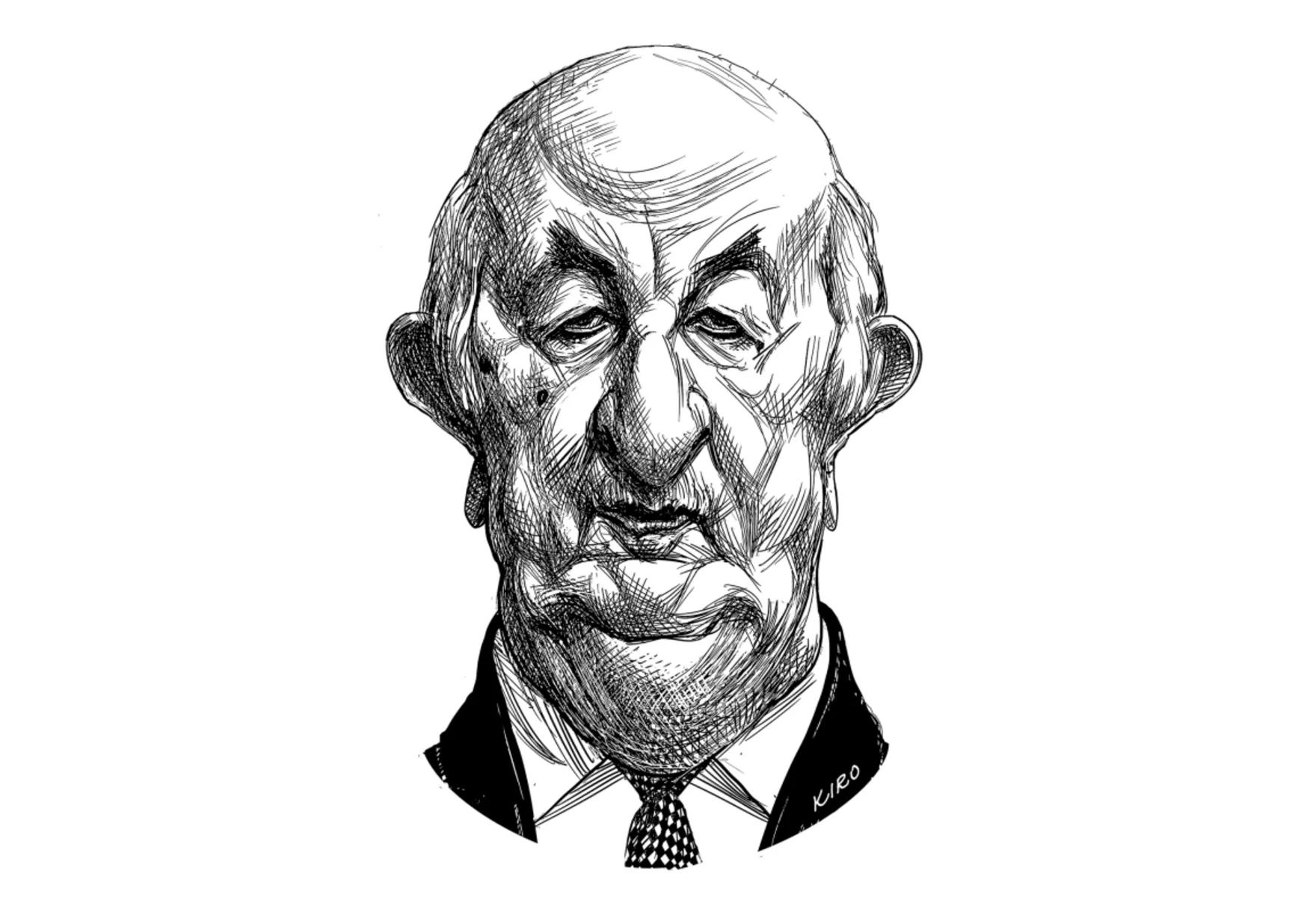Ces dernières semaines, des dizaines d’Algériens ont été arrêtés en lien avec un hashtag viral exprimant le mécontentement populaire, réduisant davantage l’espace civique six ans après le Hirak
Par Ali Boukhlef
« Nous avons beaucoup d’idées, mais la plupart d’entre elles pourraient nous conduire en prison dans la nouvelle Algérie », déclare Abdelkrim Zeghileche.
Il donne régulièrement libre cours à ses pensées sur les réseaux sociaux. Pourtant, cela lui a valu de nombreuses peines de prison depuis 2018, cet ancien entrepreneur.
Comme de moins en moins d’Algériens, il continue de publier régulièrement des messages critiques envers le gouvernement en ligne, malgré le risque de détention.
Des dizaines de personnes croupissent actuellement dans les prisons algériennes pour avoir exprimé des critiques à l’égard des autorités sur les réseaux sociaux.
Cette répression s’est intensifiée ces dernières semaines, avec l’apparition en décembre d’un nouveau hashtag exprimant le rejet des politiques gouvernementales, devenu viral dans le pays.
#Manich_Radhi ou « Je ne suis pas content, satisfait » a été partagé par des milliers d’Algériens pour exprimer leur mécontentement face à la situation sociale et politique dans leur pays ainsi que le manque de libertés.
Le slogan est apparu après la chute du président Bachar al-Assad en Syrie. De nombreux Algériens ont établi un parallèle en ligne entre ces événements et la situation dans leur pays, avertissant les autorités d’un sort similaire.

Alors que le Hirak, le vaste mouvement de protestation qui a conduit à la chute de l’autocrate de longue date Abdelaziz Bouteflika en 2019, a depuis été complètement neutralisé par les autorités, notamment par l’arrestation d’activistes, les Algériens ont vu dans le scénario syrien, où la révolution populaire semblait enfin triompher, un espoir pour leur propre lutte pour la démocratie.
Un hashtag qui peut conduire en prison
Les autorités algériennes ont répondu en arrêtant plusieurs dizaines de personnes, comme Souhil Debbaghi, un ouvrier d’usine qui avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises pour son activisme politique. Il a été arrêté à nouveau fin décembre pour avoir posté une vidéo dans laquelle il disait ne pas être satisfait de la situation dans le pays et mentionnait les nombreux jeunes Algériens qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée à la recherche d’un avenir meilleur ailleurs.
Il a été traduit en comparution immédiate et condamné à deux ans de prison. Mohamed Tadjadit, qui avait été surnommé « le poète du Hirak » pendant le soulèvement, a connu le même sort.
« Depuis 2022, des arrestations ont lieu régulièrement, mais pas en grand nombre. Cependant, en quelques jours fin décembre, le nombre de personnes arrêtées a dépassé le nombre d’emprisonnements pour l’ensemble de 2024 », déclare Zaki Hannache, militant des droits humains.
Libéré en novembre dernier dans le cadre d’une grâce présidentielle après avoir passé plus de trois ans en prison depuis 2019 pour son activisme politique, le jeune homme a été condamné à cinq ans de prison en janvier pour « incitation à la haine sur les réseaux sociaux » en raison de son implication dans la campagne Manich Radhi.
Un autre cas emblématique est celui du journaliste Abdelwakil Blamm. Après des publications établissant un parallèle entre la Syrie et l’Algérie, l’homme de 50 ans a été arrêté une première fois, libéré, puis arrêté à nouveau le 29 décembre et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt après une semaine de garde à vue.
Accusé de « diffusion de fausses informations susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale » ainsi que de « soutien à un groupe terroriste », sans que plus de détails ne soient fournis, il a été incarcéré à la prison d’El-Harrach à Alger, où il attend son procès.
Si l’arrestation d’activistes n’est pas nouvelle en Algérie, ce qui s’est passé depuis décembre est quantitativement frappant, selon Zaki Hannache, un militant algérien des droits humains désormais basé au Canada qui a lui-même été incarcéré pour son activisme en 2022.
« Depuis 2022, des arrestations ont lieu régulièrement, mais pas en grand nombre. Cependant, en quelques jours fin décembre, le nombre de personnes arrêtées a dépassé le nombre d’emprisonnements pour l’ensemble de 2024 », a-t-il déclaré à Middle East Eye.
Hannache, qui travaille maintenant pour un groupe international de défense des droits humains, a recensé environ 40 arrestations en lien avec le hashtag, dont 25 personnes sous mandat d’arrêt et le reste sous contrôle judiciaire. Les personnes concernées sont principalement des activistes connus depuis le Hirak.
« Panique » au sein des autorités
La vague d’arrestations liée au hashtag Manich Radhi est intervenue juste après l’annonce de mesures de grâce présidentielle pour 2 471 détenus, dont 14 « définitivement condamnés pour des crimes contre l’ordre public », comme le discours officiel désigne les prisonniers d’opinion. Cependant, au final, seules quelques libérations ont eu lieu. Leur nombre n’a pas été précisé mais selon Hannache, seules cinq personnes ont été libérées – des jeunes dont les cas n’avaient pas été couverts par les médias.
Plusieurs nouvelles arrestations ont été effectuées, illustrant une tendance à la libération intermittente de détenus par le biais de grâces présidentielles suivie de nouvelles arrestations dès que des campagnes de protestation et pro-démocratie sont organisées.
Selon le journaliste Mohamed Iouanoughene, le hashtag Manich Radhi a « créé une vague de panique » au sein des autorités algériennes, qui craignent plus que tout un nouveau soulèvement.
« Les dirigeants savent que s’ils libèrent les espaces civiques, le régime n’aura plus les leviers lui permettant de contrôler l’opposition, d’autant plus que les partis politiques ne sont pas bien structurés. Donc la seule solution qui reste est la répression, que le gouvernement ne parvient même pas à assumer », a déclaré Iouanoughene à MEE.
Le président Abdelmadjid Tebboune lui-même a réagi à la tendance « Je ne suis pas content » sur les réseaux sociaux.
« Que personne ne pense que l’Algérie peut être dévorée par un hashtag. Nous protégerons ce pays dont le peuple a le sang des martyrs qui coule dans ses veines », a-t-il déclaré lors d’une réunion entre le gouvernement et les préfets.
En plus des arrestations, les autorités ont répondu en encourageant la diffusion d’un contre-hashtag – « Ana maa bladi » (« Je suis avec mon pays ») – utilisé par certains Algériens pour exprimer leur solidarité avec leurs dirigeants.
Les autorités ont également mené leur contre-attaque à l’étranger, où elles tentent régulièrement de réduire l’influence des opposants basés à l’étranger sur la diaspora et même sur les Algériens au pays, où ces activistes anti-gouvernementaux sont souvent la seule source d’information.
« Les dirigeants savent que s’ils libèrent les espaces civiques, le régime n’aura plus les leviers lui permettant de contrôler l’opposition… Donc la seule solution qui reste est la répression », déclare le journaliste Mohamed Iouanoughene.
Alger a poussé des influenceurs algériens basés en France à utiliser le hashtag alternatif et à menacer les opposants, évitant ainsi toute implication directe.
La campagne a conduit à l’arrestation de plusieurs influenceurs algériens sur le territoire français, accusés de « diffuser des messages de haine » et « d’inciter à la violence » sur les réseaux sociaux. L’un d’entre eux, nommé Doualemn, a été expulsé par la France après avoir publié une vidéo sur TikTok dans laquelle il appelait à faire souffrir un manifestant opposé au gouvernement algérien. Alger a refusé d’accepter son ressortissant et l’a renvoyé, exacerbant la crise diplomatique en cours entre les deux pays depuis que le président français Emmanuel Macron a soutenu la revendication de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en juillet dernier. Le territoire non autonome majoritairement contrôlé par Rabat est revendiqué par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par Alger.
Les ingrédients d’un nouveau soulèvement ?
Selon les défenseurs des droits humains, il y a entre 200 et 250 prisonniers d’opinion en Algérie, principalement liés au mouvement de protestation de 2019. Après le bref intermède du Hirak, qui avait suscité l’espoir d’une possible transition démocratique, l’Algérie a été replongée dans la camisole de force de l’oppression sous le mandat de ses dirigeants actuels.
Élu en décembre 2019 après un vote controversé, le président Tebboune a été réélu pour un second mandat en septembre dans un contexte de répression et d’absence de débat politique significatif.
Les autorités algériennes ont été accusées par des groupes de défense des droits d’écraser la dissidence et de fermer l’espace civique en restreignant les libertés d’expression, de presse, d’association, de réunion et de mouvement. Elles ont durci les lois pénales et continué à utiliser une législation répressive – y compris des dispositions antiterroristes – contre toute voix critique.
En janvier, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits humains, Mary Lawlor, a exprimé sa consternation face à la criminalisation continue des activistes en Algérie. « Plus d’un an après ma visite en Algérie – fin 2023 – je suis profondément déçue de constater que les défenseurs des droits humains dans différents domaines de travail… sont toujours arbitrairement arrêtés, harcelés judiciairement, intimidés et criminalisés pour leurs activités pacifiques en vertu de dispositions aux formulations vagues, comme ‘porter atteinte à la sécurité de l’État' », a déclaré Lawlor.
Elle a cité, « parmi les cas les plus alarmants », celui de Merzoug Touati, un journaliste indépendant et défenseur des droits humains qui est soumis depuis des années à des procès pour « accusations fallacieuses » et a été « prétendument torturé physiquement et psychologiquement pendant cinq jours de garde à vue ».
En plus des arrestations, les autorités algériennes ont de plus en plus recours à des interdictions de voyage arbitraires pour exercer des représailles contre des personnes perçues comme critiques, ont déclaré Human Rights Watch (HRW) et le MENA Rights Group ce mois-ci.
Ces interdictions, souvent illimitées dans le temps, empêchent les personnes de quitter le pays. Imposées sans notification formelle, elles sont presque impossibles à contester.
« Ces interdictions de voyage font partie d’une campagne plus large de harcèlement continu des critiques du gouvernement, visant à faire taire la dissidence et à éradiquer l’espace civique », a déclaré Bassam Khawaja, directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à HRW. Les deux ONG ont documenté 23 cas de ressortissants algériens soumis à des interdictions de voyage, dans un modèle qui, selon elles, s’est intensifié depuis 2022.
Pour certains observateurs, tout cela constitue la formule parfaite pour un nouveau soulèvement populaire. Adel Boucherguine, l’un des dirigeants de la principale et plus ancienne organisation algérienne de défense des droits humains, créée en 1985 et dissoute en 2022 sous Tebboune, estime que « le désenchantement entre les gouvernés et les gouvernants n’a jamais été aussi grand ». Pour lui, le Hirak n’a pas dit son dernier mot. Au contraire, « tous les ingrédients sont réunis pour qu’il reprenne », a-t-il déclaré.
Comme l’exprime la tendance Manich Radhi, la frustration aujourd’hui semble en effet similaire à celle des premiers jours du soulèvement, dont le sixième anniversaire sera célébré le 22 février. Le hashtag montre que l’esprit de protestation est toujours présent, alors que la colère ne s’est pas apaisée et que le gouvernement est isolé.
Quant à savoir si le peuple est prêt à se soulever à nouveau, les opinions divergent. En attendant, face à cette énième vague de répression, le hashtag « Je ne suis pas content » a pour l’instant disparu des réseaux sociaux.
Source: traduit de l’Anglais depuis Middle East Eye